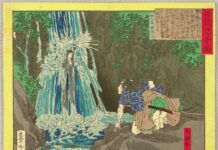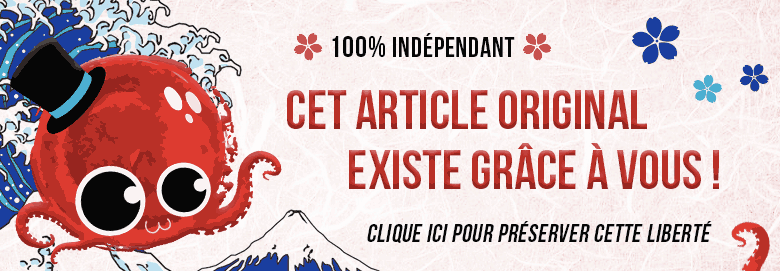Des rayons parfois vides, une hausse des prix majeure et des consommateurs esseulés : depuis l’été 2024, le Japon connaît une importante pénurie de riz, malgré le taux d’autosuffisance initial de près de 100% de l’État. Dans un pays où cette céréale est non seulement un aliment de base mais aussi une partie intégrante de la culture, cette crise perturbe la vie quotidienne de millions de personnes et soulève des questions cruciales sur les politiques agricoles et la sécurité alimentaire du Japon. On fait le point.
Le riz, une denrée rare au Japon ? En plein mois d’août 2024, plusieurs enseignes alimentaires, à commencer par les supermarchés Ito-Yokado, limitaient les achats à un paquet de riz par famille, alors que les prix de la céréale s’envolaient. En cause ? Une conjoncture particulière alliant baisse de l’offre disponible et augmentation de la demande, laissant la population perplexe dans un pays qui se prévaut pourtant de couvrir 100% de ses besoins dans ce domaine.

Une demande en hausse, une offre sous tension
Selon le ministère de l’agriculture, les stocks du secteur privé étaient tombés à 1,56 million de tonnes en juin 2024, le niveau le plus bas depuis le début de ces statistiques en 1999 et en baisse de 20 % par rapport à 2023, rapporte le Monde. En parallèle, l’indice des prix à la consommation du riz a enregistré une hausse de 48 % en septembre 2024 par rapport à la même période en 2023, soit la plus forte hausse en 31 ans, note le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF). Des prix qui ont continué d’augmenter en 2025.
Premier facteur en cause : des conditions climatiques difficiles, qui ont sans aucun doute contribué à des mauvaises récoltes chez les agriculteurs, alors que 2023 fut marquée par des « températures considérablement supérieures » aux normales de saison, souligne l’Agence japonaise de météorologie (JMA). Un thermomètre en hausse allié à un fort déficit pluviométrique, il n’en fallait pas plus pour que les cultures rizicoles subissent une importante dégradation de leur qualité. “En 2023, seul 5 % du riz de la populaire variété Koshihikari récoltée dans le département de Niigata, l’un des principaux producteurs, a été jugé de première qualité. Or ce ratio est habituellement de 80 %”, rapporte Philippe Mesmer, correspondant à Tokyo. Ces chiffres indiquent que ce problème climatique est loin d’être anecdotique.
à peine 60 % des rizières sont exploitées
Le déclin préoccupant des stocks s’explique aussi par le vieillissement de la population des agriculteurs, dont les terres trouvent difficilement repreneur. La nouvelle génération est attirée par la vie en ville et ses emplois urbains. Cette crise démographique s’ajoute à une politique amorcée dans les années 1970, visant à réduire les surfaces agricoles pour soutenir les revenus des producteurs, alors que la consommation domestique de riz commençait à s’écrouler au profit du pain et des pâtes. “Aujourd’hui, à peine 60 % des rizières sont exploitées. La production est maintenue autour de 7 millions de tonnes par an, moins de la moitié du pic de 14,45 millions de tonnes. Et le gouvernement promeut les exportations, le riz nippon étant très prisé à l’étranger”, explique le journaliste.
Un aliment de base qui pèse sur les budgets
En parallèle, la demande croît entre juin 2023 et juin 2024 de 110 000 tonnes pour s’établir à 7,02 millions de tonnes. Le retour des touristes après la pandémie de Covid-19 explique en partie cette tendance, alors que le Japon accueillait 17,78 millions de visiteurs étrangers au premier semestre 2024. En outre, les approvisionnements ont également été affectés par les nombreux achats de panique déclenchés par les alertes aux typhons et aux tremblements de terre émises par les autorités cet été-là.
Résultat : une pénurie de riz sans précédent pour l’archipel nippon. L’impact économique de la crise a été évident dans tous les secteurs, notamment dans la restauration et l’hôtellerie. Elle a également engendré des difficultés financières pour les familles à plus faibles revenus, privées d’un aliment de base implanté dans la tradition culinaire. “La hausse des prix du riz a conduit les restaurants et les marques alimentaires à augmenter les prix des plats à base de riz, voire, dans certains cas, à réduire les portions, s’attirant des critiques pour avoir répercuté cette hausse sur les consommateurs”, explique Tae Yeon Eom, chercheur à la Fondation Asie-Pacifique du Canada.
En moyenne, un japonais consommait environ 50,9 kilogrammes par an de riz en 2022, soit l’équivalent d’environ deux bols de riz par jour. Depuis le début de la crise, les habitudes alimentaires ont évolué face à l’impératif économique : “alors que le riz devenait de plus en plus cher et rare tout au long de l’été 2024, de nombreux consommateurs se sont tournés vers des céréales et des aliments alternatifs, notamment des produits à base de blé comme le pain et les nouilles”.

Des mesures gouvernementales attendues de pied ferme
Alors que le gouvernement était resté jusque-là attentiste face à la crise, il annonce en février dernier le déblocage de 212 000 tonnes de riz issues de ses réserves d’urgence pour libérer les marchés de la pression engendrée. Depuis lors, l’Etat est contraint de poursuivre sa démarche devant une hausse des prix qui persiste. “Le gouvernement vendra ses stocks de riz chaque mois jusqu’à l’été pour stabiliser la hausse des prix du riz en créant un approvisionnement stable pour les consommateurs”, annonçait le ministre de l’Agriculture Taku Eto en avril.
Depuis la constitution des stocks nationaux en 1995, le Japon n’avait jusqu’ici puisé dans ses réserves que pour faire face aux années de disette, c’est-à-dire à une forte baisse de la production, et non à une forte augmentation de la demande. Mais malgré de nouvelles récoltes plutôt satisfaisantes, Tokyo se voit contraint d’agir face à un marché qui peine à se réguler dans un contexte de spéculations grandissant où les coopératives d’agriculteurs et les grossistes font des réserves en prévision de nouvelles hausses de prix.
Le poids de l’héritage politique
Un tournant majeur dans la politique alimentaire du pays, alors que le gouvernement japonais privilégie depuis la fin de la guerre la protection des producteurs nationaux de riz en limitant l’offre disponible pour assurer la sécurité alimentaire et préserver les moyens de subsistance du milieu rural. “Cette approche est renforcée par l’influence politique des communautés rurales, qui détiennent un pouvoir disproportionné dans le système électoral japonais”, décrypte Tae Yeon Eom. “Sur le plan économique, les subventions accordées aux riziculteurs et le contrôle des prix constituent un filet de sécurité essentiel pour les petits exploitants, les rendant fortement dépendants du soutien public, une pratique peu propice à la libéralisation du marché”.
Une analyse rejointe par Masayoshi Honma, professeure émérite à l’Asian Growth Research Institute, pour qui “cette inaction reflète des considérations politiques. Si les réserves de riz sont libérées, le prix chute, ce qui serait préjudiciable aux producteurs. Or, ces producteurs – agriculteurs et coopératives agricoles – sont généralement d’importants soutiens du Parti libéral-démocrate au pouvoir”.
Une politique alimentaire remise en question
Alors que les grands exportateurs de riz ont accru leur production, le Japon a choisi de limiter délibérément la sienne en réduisant les surfaces cultivées, afin de prévenir les excédents et de stabiliser les prix. Résultat : la production rizicole japonaise est restée presque constante depuis près de 60 ans. Si cette stratégie a rempli son objectif en protégeant le revenu des agriculteurs nationaux, elle a également entraîné une augmentation des coûts pour les consommateurs et affaibli la capacité du secteur à faire face à des crises d’approvisionnement, comme la pénurie actuelle.
A travers le pays, des voix s’élèvent pour exiger une politique alimentaire plus favorable aux consommateurs, en accord avec l’esprit de la Loi fondamentale révisée de mai 2024 sur l’alimentation, l’agriculture et les zones rurales, qui accorde la plus haute priorité à la sécurité alimentaire et appelle à la mise en place d’un système d’approvisionnement alimentaire en cas d’urgence. “La crise du riz a révélé des problèmes plus profonds dans les politiques de sécurité alimentaire du pays”, souligne Masayoshi Honma. Dans l’espoir de sortir grandi de la crise, “le Japon a l’opportunité d’adopter une approche plus résiliente et transparente, qui non seulement garantisse l’approvisionnement physique, mais préserve également la confiance du public en période d’incertitude”, conclut la professeure.
– Mr Japanization