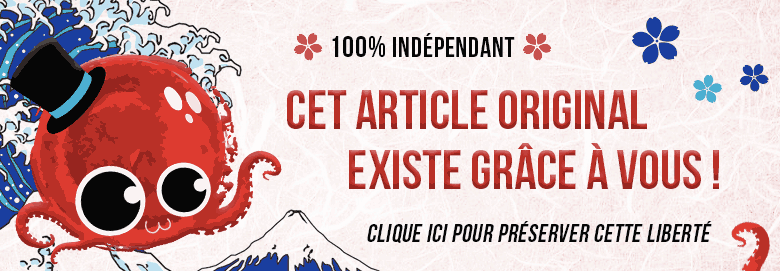Le Japon, longtemps l’un des principaux pourvoyeurs de touristes sexuels en Asie, est progressivement devenu lui-même une destination prisée des étrangers.
À Kabukichō, à Tokyo, les néons fluorescents transparaissent sur la buée des bouches d’aération des restaurants. Entre deux clubs aux enseignes clignotantes et aguicheuses, les filles, principalement, défilent pour satisfaire une clientèle qui vient de plus en plus de l’étranger.
Rien de comparable au vaste marché à ciel ouvert que sont la Thaïlande ou les Philippines : le pays aime à se voir et à se montrer comme fondamentalement pudique, régulé, respectueux de la vie privée. Pourtant, dans les interstices de ce modèle policé affleurent des réalités moins avouables : une industrie du divertissement pour adultes extrêmement développée, que ce soit des Japonais en Asie ou des flux touristiques attirés par les sous-cultures érotiques nippones, et des alertes récurrentes d’ONG sur la vulnérabilité de certains mineurs. Décryptage d’une tendance naissante et clandestine.
Des Japonais grands consommateurs
Si l’on veut saisir le regard porté aujourd’hui sur la sexualité marchande au Japon, il faut savoir que le pays est aussi un fournisseur historique de clients du tourisme sexuel. Dans son 5ᵉ rapport mondial (2019), la Fondation Scelles dresse un portrait sans détour :
« Le Japon est à la fois pays d’origine de touristes sexuels, pays de destination pour certains réseaux, pays où persistent des formes d’exploitation interne. »
Le tourisme sexuel japonais s’est certes réduit, mais il a laissé une empreinte durable, pesant encore sur l’image du pays dans les débats internationaux.
Lorsque le politologue David Leheny publie en 1995 A Political Economy of Asian Sex Tourism, il brise un tabou : pendant les décennies 1980 et 1990, les Japonais ont été parmi les principaux sex tourists en Asie du Sud-Est. Leheny y montre comment agences de voyage, pouvoir d’achat et imaginaires masculins ont produit des circuits parfaitement identifiés vers Bangkok ou Manille, comme le montre tristement si bien le film Bangkok Nites.
Une enquête de terrain menée par Fumihiko Yokota, auprès d’hommes japonais en Thaïlande révèle leur rhétorique : “Ici, on peut faire ce qu’on ne peut pas faire au Japon.” Parce que si le Japon attire aujourd’hui des touristes étrangers, il porte aussi une mémoire refoulée de mobilité masculine structurée par la consommation sexuelle.
Une économie du sexe lucrative

La Prostitution Prevention Law de 1956 a interdit la prostitution au Japon, en la définissant de manière extraordinairement restrictive : « les rapports sexuels contre rémunération. »
Cette définition volontairement étroite a été conçue pour éradiquer la prostitution de rue et des quartiers officiels, tout en préservant ce que l’historienne Seiko Hanochi appelle dans A Historical Perspective on Japanese Sex Trade “l’économie du plaisir”, profondément enracinée dans l’histoire urbaine japonaise.
Hanochi montre que cette stratégie législative permettait à l’État de mettre fin à la visibilité publique de la prostitution, jugée incompatible avec la modernisation d’après-guerre, sans supprimer l’ensemble des activités commerciales autour de la sexualité, qui représentaient à la fois un secteur économique important et un espace traditionnel de sociabilité masculine, comme on peut le voir dans de nombreux mangas.

Cette faille juridique, interdisant l’acte sexuel, mais autorisant toute une gamme de services sexuels non pénétratifs, a permis à l’économie du seijin fūzoku, « divertissement pour adultes » de se développer massivement à partir des années 1960.
Un business bien juteux
Si l’on parle d’ “industrie” du sexe, c’est parce que le fūzoku (風俗), qui signifie étrangement « bonnes manières« , « coutumes » ou « moralité publique« , fonctionne comme un véritable système productif. Il articule plusieurs sous-secteurs : clubs d’hôtesses, host clubs, bars, soaplands, services d’accompagnement, image clubs, love hotels, agences d’intermédiation… Un écosystème fondé sur les services sexuels commerciaux, dont une partie relève juridiquement de la prostitution, et qui, selon une étude sur le trafic d’être humains au Japon, rapporterait environ 2,3 billions de yens par an – soit près de 12,65 milliards d’euros (décembre 2025). Un chiffre qui correspondrait à 1–3 % du PIB japonais en 2009, un pourcentage comparable à celui de l’hôtellerie-restauration. Or, il est fort à parier que ce pourcentage a augmenté depuis.
Une architecture économique ancrée
Cette architecture économique repose également sur une multitude d’acteurs invisibles. Comme le montre Anne Allison, dans Nightwork, les clubs d’hôtesses s’appuient sur toute une économie périphérique, en allant du studio photo, aux maquilleurs, aux coiffeurs, taxis, jusqu’aux fournisseurs de costumes – indispensables. De son côté, l’économiste Kadokura Takashi décrit comment l’“industrie du bas du corps” repose aussi sur des propriétaires immobiliers et des entreprises de sécurité spécialisées, qui structurent l’espace commercial de Kabukichō.
“Le club n’est pas un espace de déviance, mais un lieu où se reproduisent les valeurs mêmes de l’entreprise japonaise : hiérarchie, loyauté, solidarité masculine.”
Cette phrase est tirée du résumé de J.B Moore à propos de Nightwork d’Anne Allison. Les femmes deviennent les vecteurs d’une forme d’affect lucratif, au service de la cohésion interne des groupes d’hommes. Un classique du salarymen japonais, sur notes de frais, dans le cadre de la sociabilité d’entreprise. Mais cette économie glisse doucement pour attirer une clientèle venue de l’étranger.
Quand l’industrie s’adapte discrètement aux visiteurs étrangers

Dans une étude du professeur et chercheur Austin Uzama intitulée Sex Tourism: A Match Through Japan’s Romance Dori Street, l’auteur montre comment certaines rues, notamment Romance Dori, à Osaka, se sont progressivement tournées vers une clientèle non japonaise, en traduisant menus, panneaux et brochures.
Rien d’explicite : pas de panneaux aguicheurs destinés aux touristes, encore moins de slogans en anglais vantant les charmes locaux. Mais une série d’ajustements visibles en marchant.
Les bars et salons qui jalonnent la rue ont ajouté des menus et affiches en anglais, parfois en chinois ou en coréen. Les tarifs, autrefois cryptiques, sont désormais affichés clairement, pour éviter malentendus et arnaques.
Certains établissements emploient même des employés capables d’expliquer en anglais comment fonctionne le système japonais : paiement en avance, durée fixe, interdits légaux. Une manière, note Uzama, de rendre l’écosystème lisible pour ceux qui n’en maîtrisent pas les codes.
La fin des zones « no foreigners »?
Il ne s’agit pas de cibler les touristes, mais de ne plus les exclure. Dans un secteur où le “ no foreigners” reste courant, ces adaptations constituent un tournant pragmatique : les professionnels savent que la demande existe, et qu’une partie des visiteurs est attirée par les sous-cultures érotiques japonaises : cosplay, kawaii, imaginaires manga, plus que par la perspective d’un rapport sexuel tarifé.
Cette évolution ne transforme pas le Japon en hub mondial du tourisme sexuel, mais révèle comment ses formes culturelles exportées dites “soft power” infusent désormais jusque dans l’économie nocturne.
Osaka n’est pas seule : d’autres quartiers au Japon ajustent aussi leurs codes pour que l’étranger puisse consommer les corps sans se perdre. Une ouverture, certes limitée, mais révélatrice d’un pays où l’économie du plaisir se mondialise malgré elle, par petites touches, sans jamais l’avouer trop fort.
Mineurs : l’alerte qui revient comme une marée
La traite de mineurs est partout un problème, même, voire surtout, dans un pays strictement normé comme le Japon.
L’enjo kōsai et “JK business” : des tendances qui attirent

Dans les années 1990, l’enjo kōsai, qui signifie « relation d’assistance rémunérée » attire une attention internationale intense. Il s’agit le plus souvent de rencontres entre des jeunes filles et des hommes dans la force de l’âge, à la manière du « sugar dating ». Les médias étrangers, comme The Guardian s’emparent du sujet, souvent en le dramatisant. Mais aussi, effet domino, en faisant connaître un phénomène qui peut attirer plus d’un touriste.
Les travaux de Sharon Kinsella, notamment Schoolgirls, Money and Rebellion in Japan et ses chapitres dans Adult Manga, éclairent aussi la manière dont l’esthétique et la culture des lycéennes sont devenues un symbole ambivalent : à la fois rébellion, consommation et fantasme médiatisé.

Il en est de même avec l’émergence des JK businesses (女子高生ビジネス), ces cafés et services para-commerciaux, où des adolescentes employées en uniforme proposent discussion, marches ou jeux. La majorité ne proposent rien d’illégal, mais fonctionnent dans une zone grise pouvant faciliter certaines formes d’exploitation.
C’est ici que se dessine le lien, indirect mais réel, avec le tourisme sexuel. Il ne s’agit pas d’une demande d’actes illégaux – les lois japonaises sont strictes, notamment le Child Prostitution and Child Pornography Act, mais d’une circulation internationale de l’imaginaire érotique japonais. Les travaux de Patrick W. Galbraith, Otaku and the Struggle for Imagination in Japan, montrent comment ces codes – uniformes, kawaii, fétichismes visuels, cosplay – deviennent des interfaces culturelles et sexuelles pour certains visiteurs étrangers.
La précarité renforce cette attraction
Le rapport Country Overview – Japan d’ECPAT (2017) décrit trois failles structurelles dans le pays : la précarité croissante des jeunes les plus vulnérables, les zones grises de l’industrie du divertissement, et la difficulté à contrôler les plateformes numériques utilisées pour le recrutement ou les contacts.
Selon le réseau ECPAT/STOP Japan, actif depuis 1992, ces facteurs créent “un environnement où l’exploitation peut prospérer dans l’ombre”, malgré un arsenal légal strict. Ces signaux d’alerte résonnent aujourd’hui avec les observations faites à Tokyo. Un article de 20 minutes rapporte les propos de “Ria”, 23 ans, pour qui “la moitié clients sont des touristes”, et celui d’une autre travailleuse expliquant : “La crise a fait baisser les prix. On n’a pas le choix”
La faiblesse du yen en cause
La faiblesse du yen, l’augmentation du coût de la vie et la montée du tourisme international ont créé un effet mécanique : des Japonaises, souvent jeunes, parfois très précaires, se retrouvent à dépendre davantage de clients occasionnels, dont une part significative sont désormais des visiteurs étrangers. Concrètement, la pauvreté rend les jeunes plus faciles à approcher, et les touristes plus difficiles à suivre.
Ce glissement ne fait pas du Japon une destination officielle du tourisme sexuel. Mais il révèle un phénomène discret : la précarité intérieure alimente la demande extérieure, dans ces interstices de la nuit où économie du plaisir, vulnérabilité sociale et flux touristiques se rencontrent, loin des radars officiels.
– Mauricette Baelen