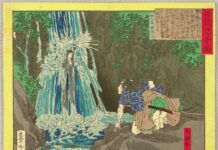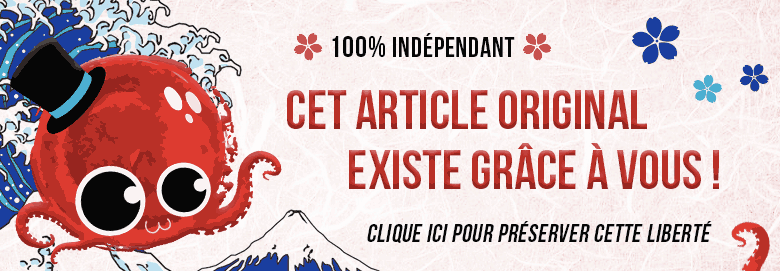Attouchements non consentis dans les trains, mains baladeuses dans la foule : au Japon, le “chikan” est un phénomène largement répandu. Selon une vaste enquête gouvernementale menée auprès de 36 000 jeunes de 16 à 29 ans, plus de 10 % des répondants disent avoir été victimes d’agressions sexuelles ou d’actes obscènes en public — des violences touchant presque exclusivement les femmes. Pourtant, 80 % des victimes ne portent pas plainte. Un silence révélateur d’une culture patriarcale persistante et d’un système de protection des victimes défaillant.
Le chikan — ces attouchements sexuels non consentis dans les lieux publics — reste un phénomène courant au Japon, où les réseaux ferroviaires transportent chaque jour des millions de passagers, souvent tassés dans des wagons bondés aux heures de pointe. Selon une enquête menée en février par le Cabinet Office auprès de plus de 36 000 jeunes âgés de 16 à 29 ans, 10,5 % des personnes interrogées déclarent avoir été victimes d’agressions sexuelles ou d’actes indécents dans l’espace public.

1 femme sur 10 victime d’attouchement avant 30 ans
Parmi elles, 90 % sont des femmes. Deux tiers des victimes rapportent que les faits se sont produits à bord d’un train, et un nombre similaire évoque les heures de pointe du matin ou du soir comme moment de l’agression. D’autres ont été agressées ailleurs dans l’espace public : dans un magasin, dans la rue ou même au cinéma. Parmi les personnes interrogées, certaines ont également déclaré avoir été agressées à plusieurs reprises, voire « presque quotidiennement » alors qu’elles étaient encore au lycée. Et pour cause : 46,4 %, des répondants avaient entre 16 et 19 ans lorsqu’ils ont été touchés pour la première fois, tandis que 35,4 % avaient 15 ans ou moins.
Si près de 800 auteurs présumés de chikan sont arrêtés chaque année à Tokyo, la réalité des chiffres cache une impunité massive : 80 % des victimes n’en parlent pas à la police. En cause, une série de freins tenaces : méconnaissance de la gravité des faits, sentiment que le signalement ne servirait à rien, peur de ne pas être crues ou encore procédures judiciaires jugées complexes. Des chiffres édifiants, qui illustrent la persistance d’une culture patriarcale et sexiste profondément enracinée dans la société japonaise.
Un phénomène « courant » trop peu dénoncé
« Vous parlez à n’importe quelle femme japonaise et elle vous dira que c’est très courant », rapporte à CNN Jeffrey Hall, professeur d’études japonaises à l’Université d’études internationales de Kanda à Chiba, qui estime les résultats de l’enquête « étonnamment bas ».
Alors que les efforts pour lutter contre le phénomène ont commencé au début des années 2000, avec de grandes villes comme Tokyo qui ont commencé à installer des wagons réservés aux femmes dans les trains, les résultats restent insuffisants pour une partie des répondants à l’enquête. Ces dernières années, les autorités ont renforcé la surveillance dans les transports publics : davantage de caméras ont été installées dans les gares et les rames, tandis que la police ferroviaire — en uniforme ou en civil — a intensifié ses patrouilles.
Des initiatives plus récentes cherchent à impliquer le public dans la prévention des agressions : tampons « anti-attouchements » laissant une marque invisible sur les agresseurs, applications mobiles permettant de signaler les incidents, ou encore campagnes d’affichage invitant les victimes et les témoins à dénoncer les faits. Autant de tentatives pour briser le silence, qui demeure encore trop souvent la norme face à ce fléau. « Dans l’ensemble, il y a un sentiment de résignation et de déception que les autorités n’ont pas été en mesure d’empêcher », regrette le professeur auprès du média américain.
Des stigmates profonds pour les victimes
Pourtant, les conséquences pour les victimes sont durables et bien réelles. L’enquête souligne l’impact psychologique des attouchements et mentionne un traumatisme à long terme. « Le souvenir des attouchements ne s’efface jamais, même après tant d’années. Je veux que l’agresseur sache que j’ai été traumatisée pendant longtemps », déplore une des personnes interrogées. Parmi les réponses multiples proposées, 17,5 % déclarent avoir développé une peur de sortir, 14,6 % souffrent de flashbacks, 13,1 % disent craindre toute interaction avec le sexe opposé et 10,5 % évoquent une détresse physique ou mentale persistante.

Face à ces chiffres alarmants, les experts appellent à un sursaut collectif : une meilleure sensibilisation du public, une écoute active et bienveillante des victimes, mais aussi une réforme en profondeur du traitement judiciaire de ces violences. Takayuki Harada, professeur à l’Institut des sciences humaines de l’Université de Tsukuba, plaide pour une réponse pénale plus ferme : « sauf cas particulièrement grave, le harcèlement n’est pas considéré comme une infraction pénale par le Code pénal japonais. Il est généralement considéré comme une simple violation des arrêtés locaux, passible au maximum d’une amende », déplore-t-il dans une tribune au Japan Times. « Cette clémence minimise la gravité du crime ».
L’action suivra-t-elle l’indignation ?
En 2017, Kumi Sasaki, une jeune japonaise installée en France, témoigne des agressions sexuelles répétées dont elle a été victime dès l’âge de 12 ans dans le métro de la capitale. Dans un livre nommé Tchikan, elle révèle les traits de ses prédateurs : « des hommes ordinaires, de tout âge, des salaryman en costume cravate, qui opèrent dans la foule compacte aux heures de pointe ». Alors que les agressions s’enchaînent et que les stations défilent, “personne ne les voit ou ne veut les voir, et les familles, tout comme la société, restent dans le déni de cette violence masquée”. Le Japon est-il enfin sur le point de changer de regard face à cette violence systémique ? Reste à voir si la société, les institutions et la justice oseront transformer l’indignation en action durable.