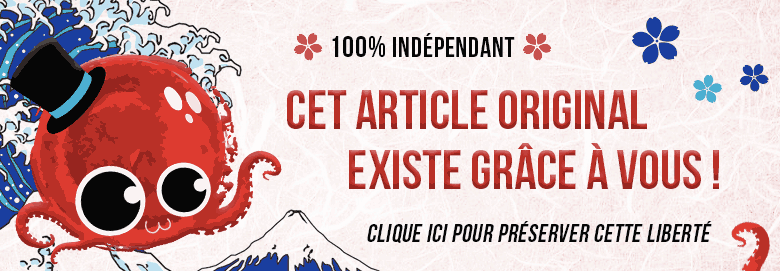Tokyo (AFP) – Il fait nuit sur Tokyo. La petite salle de karaoké est bondée, enfumée, alcoolisée. Chope de bière en main, Shinsuke Chiba se lance dans une version improbable d’un succès des Sex Pistols. Le jour, c’est un vendeur d’assurances, tout gentil tout gris.
Chiba, 41 ans, est marié, père de deux enfants. Et comme des millions d’autres Japonais, il ne verra ce soir-là ni sa femme ni ses petits. Ni ce soir, ni peut-être demain soir, ou les soirs d’après. Il rentrera trop tard, trop vaseux aussi sans doute, par le dernier train de banlieue. M. Chiba fait partie des « salarymen », ces millions de dociles fantassins de la « Japan Inc » qui, au sortir des bureaux, envahissent les rues des grandes villes du Japon pour aller s’entasser dans des izakayas (restaurants) et boire, rire, parler, se désinhiber « entre collègues », oublier les heures interminables de boulot, jusqu’à 12 ou plus par jour.

Beuveries = soupape
Une fois « sur zone », ces hordes de costumes noirs et chemises blanches se déboutonnent au propre et au figuré. La cravate est dénouée, la veste tombée, dans le meilleur des cas sagement pliée. Et plus les joues s’empourprent, plus les conversations se risquent sur le bizarre, touchent à l’intime, voire au très intime.
Le lendemain, de retour au bureau, tout le monde aura heureusement oublié ces « confessions » alcoolisées de la veille, mais au moins la soupape aura bien fonctionné.
« Boire, ça nous aide à nous détendre », assure Kiyoshi Hamada, un employé de banque de 54 ans.
Le premier prix à payer pour ce rituel « sociolcoolique » est l’épreuve du retour à la maison. Commence alors la grande transhumance nocturne et souvent zigzagante vers de lointaines banlieues.
Malgré un costume souvent en vrac, le salaryman tente de rester digne et surtout éveillé pour ne pas rater son arrêt, et les derniers trains filent dans un concert de ronflements et autres éructations.

« Les salarymen sont un des sujets favoris des histoires drôles. On se moque d’eux allègrement, mais au fond on les admire, ces bons soldats de l’entreprise Japon », analyse Jeff Kingston, le directeur des études asiatiques à l’Université Temple de Tokyo.
L’image du salaryman – costume noir, chemise blanche, sans oublier l’indispensable badge d’accès à sa boîte autour du cou – s’est un moment confondue avec celle du Japon triomphant dans les années 1970-1980. Et à l’étranger s’est alors imposé le cliché de ces « Men in black » comme symbole du Japon conquérant.
Un job dès la sortie de la fac, souvent un emploi à vie en échange d’un dévouement sans limite à l’entreprise, la partie de golf du week-end pour entretenir des contacts professionnels: la vie du « salaryman-type » était réglée comme du papier à musique et la partition a été jouée sans fausse note pendant des décennies… jusqu’à l’effondrement de la bulle spéculative financière et immobilière au début de la décennie 1990.
« Karoshi », la mort d’excès de labeur
Avec des salaires gelés, la fin de l’emploi à vie garanti, moins d’argent de poche donné aux épouses (quand ils en ont), les « salarymen » ont perdu de leur superbe. Pour certains, c’est aussi le temps de l’inquiétude, du craquage nerveux aussi, connu ici sous le nom de karoshi: ces employés modèles qui meurent d’un excès de labeur.
Alcoolisme, surmenage, insondable solitude du mari qui ne voit plus sa femme, du père qui ne voit plus ses enfants: « longtemps la société a nié tous ces problèmes », explique Jeff Kingston.
« Ici, au Japon, ça a toujours été boulot boulot. Mais aujourd’hui c’est encore plus pénible. Le travail avant la famille, c’est sans doute très japonais », justifie l’employé de banque Hamada.
Une partie des salariés plus jeunes ont tenté d’en finir avec cette idée bien ancrée d’une existence totalement soumise à l’entreprise, « tenant davantage à leur vie privée et voulant éviter que le boulot l’emporte sur tout le reste », selon M. Kingston.
Certains, comme Takao Ono, un employé d’une compagnie de distribution d’eau, ont en effet senti le vent du boulet.
« L’an dernier, j’ai eu une période où je trimais vraiment trop. J’avais toujours le corps engourdi, l’estomac en vrac, la vision trouble et des maux de tête. C’était à cause du stress et de la surcharge de travail. J’ai dû m’arrêter quelque temps ».
En 2012, plus de 800 cas de karoshi ont été reconnus.