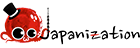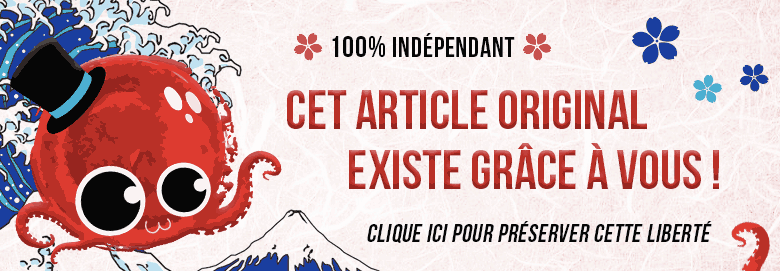En 2004, Hayao Miyazaki mettait en scène Le Château ambulant, adaptation d’un roman de Diana Wynne Jones. Presque 20 ans plus tard, c’est au tour de Gorō Miyazaki, son fils, de plonger dans la bibliographie de la romancière britannique avec Aya et la sorcière. Premier film entièrement en images de synthèse des Studios Ghibli, le long-métrage est disponible depuis le 18 novembre en streaming sur « Netflix ». Hélas, le tampon prestigieux des rois de l’animation japonaise n’est plus symbole de réussite… Que s’est-il passé ?
L’histoire : Aya et la sorcière commence par la fuite d’une femme à moto qui dépose Aya, alors qu’elle n’est encore qu’un nouveau-né, devant la porte d’un orphelinat. Cette belle femme à la chevelure de feu lui confie qu’elle reviendra la chercher quand les 12 sorcières ne la poursuivront plus. Le bébé devient une enfant turbulente et manipulatrice passée maître dans l’art de faire ce qu’elle veut des enfants et des adultes qui l’entourent dans l’établissement.
Pourtant, un jour, elle doit quitter ce monde dans lequel elle est reine puisqu’elle est adoptée par Mandrake et Bella Yaga, un homme et une femme qui s’avèrent être : des sorciers ! Aya va devenir l’assistante de ce duo pas comme les autres.
Ghibli : histoire d’un standard de qualité
Quand on entend les mots Studio Ghibli, ce sont d’abord des images enchanteresses qui nous viennent à l’esprit. Loin de nous l’idée de refaire ici la genèse du studio, maison des réalisateurs japonais Hayao Miyazaki et Isao Takahata, et chantre de la qualité en matière d’animation. Depuis maintenant près de 40 ans, les deux maîtres nous ont offert des sommets de cinéma qui en ont marqué l’histoire comme les esprits. Mon voisin Totoro, Porco Rosso ou Le Voyage de Chihiro pour le premier. Le Tombeau des lucioles, Pompoko ou Le Conte de la princesse Kaguya pour le deuxième et pour n’en citer que quelques-uns. Autant dire que Ghibli est synonyme d’excellence dans son milieu, mettant en plus en point d’orgue le caractère traditionnel de sa manière de produire ses films. Chaque séquence est peinte à la main par des animateurs et dessinateurs et, si vous en avez la possibilité, nous ne pouvons que vous motiver à la visite du Musée Ghibli de Mikata, dans la banlieue ouest de Tokyo, pour vous rendre compte de l’extraordinaire de l’entreprise.

Quand a été annoncé qu’Aya et la sorcière serait le premier film du studio japonais en images de synthèse, notre sang n’a fait qu’un tour. Quand nous avons appris qu’il serait réalisé par Gorō Miyazaki, il en a fait un deuxième. Mais, malgré ces craintes, l’optimisme aveugle que nous vouions aux artificiers de Ghibli nous faisait garder espoir. Alors que vient de sortir le film en France et directement sur Netflix, nous pouvons laisser nos espoirs au placard et n’être que les témoins de cette déception avec du vague à l’âme. Autant le dire sans détour : on peine à croire qu’il s’agit d’une production Ghibli et non pas d’un simple dessin animé diffusé le matin à la télévision entre deux pages de publicités.
Un Gorō et des bas
Gorō Miyazaki, fils d’Hayao, réalise, avec Aya et la sorcière, son troisième long-métrage. On lui doit déjà Les Contes de Terremer et La Colline aux coquelicots, deux films qui a leur sortie avaient eu quelques difficultés à convaincre, sans pour autant être mauvais. Hélas, ce n’est pas le dernier qui va redorer le blason de metteur en scène. Pourtant, cette adaptation d’un roman de Diana Wynne Jones avait tous les ingrédients de départ pour faire un bon Ghibli.
De la fantaisie, de la magie et une jeune héroïne. Sauf que la recette est au final complètement fade. Véritable tête à claque, Aya n’est pas vraiment un personnage auquel on s’attache. Elle fait ce qu’elle veut et n’évolue pas du début à la fin du film. Elle continue à manipuler tout le monde et, le pire, c’est que ceux qui l’entourent finissent tous par se faire avoir et tombent dans le panneau. On se trouve projeté tellement loin de l’esprit d’origine des films de Miyazaki où les filles sont généralement des femmes intelligentes, courageuses et bienveillantes.

Bien que ne durant que 1h20, le manque de rythme et l’absence de poésie du film font que l’on s’ennuie rapidement à défaut d’être captivé par cette histoire sans grands enjeux. Le fait qu’Aya et la sorcière se passe à 95% dans la maison des sorciers n’aide vraiment pas et ce côté « huis clos » bride les aventures de la jeune fille. Ce ne sont non pas plus les pièces « secrètes » qui vont nous émerveiller. Ce film avait besoin de plus de magie, de rire et d’émotions. Seules les dernières minutes – qui ouvrent la porte à une suite – nous donnent un léger espoir d’un monde plus grand et plus intéressant. Ce sentiment très mitigé peut s’élargir également à l’aspect technique…
Synthèse de faim damnée

À décharge, il faut savoir qu’au départ le long-métrage est coproduit par NHK et qu’il a été pensé comme un téléfilm diffusé le 30 décembre 2020 sur la chaîne japonaise. Est-ce que cela peut expliquer le manque de moyens techniques évident ? En tout cas, il est difficile de ne pas voir dès les premières minutes que le long-métrage est à des lieux des standards actuels en matière d’images de synthèse.
Tout ici manque de détails et d’attentions. Les décors sont criards et les expressions des visages ratées. Dès qu’Aya fait une grimace, nous en faisons une nous aussi tellement nous sommes surpris par cette drôle de frimousse. On n’est pas loin du rendu d’un jeu vidéo produit dans la précipitation pour sortir à Noël… Par ailleurs, l’histoire est censée se dérouler en Angleterre au début des années 90 et on a bien du mal à y déceler une quelconque atmosphère british tant les décors sont plats et sans âme.

Là où les productions Ghibli frappent d’habitude fort, c’est sur le character design des personnages et des petites créatures. L’Art du détail, précisément. La plupart du temps, il suffit de les découvrir une fois pour avoir envie de les avoir en porte-clés… Oubliez cette idée dans Aya et la sorcière. Ici, tout est plutôt banal, et ni le chat, ni les espèces de Minions de Mandrake ne vous laisseront un souvenir impérissable. Aucun personnage n’est vraiment attachant ou inspirant.
Banal et oubliable, ce sont hélas deux adjectifs qui nous viennent quand nous repensons à Aya et la sorcière. Peut-être attendions-nous trop de ce long-métrage estampillé malgré lui du sceau du Studio Ghibli. Peut-être aussi qu’à l’inverse des films de Miyazaki Père qui touchent toutes les générations, celui de Miyazaki Fils est essentiellement destiné aux très jeunes enfants qui y trouveront peut-être un bon moment avec cette canaille d’apprentie sorcière.

Dire que l’œuvre du paternel est un fardeau extrêmement lourd à porter pour le pauvre Gorō serait un euphémisme et on espère que cet échec aidera le réalisateur de 54 ans (80 ans pour Hayao) à se transcender pour sa prochaine œuvre. À moins qu’il n’y voie plutôt une preuve qu’il n’est peut-être pas fait pour marcher sur les pas de ce géant qu’est son père.
D’une manière plus philosophique, la génération bercée par les œuvres douces et profondes d’Hayao Miyazaki voit également approcher la fin d’un cycle. En dépit des dénonciations et des luttes, le monde s’est artificialisé en quelques décennies, la nature agonise et tout semble parfois désenchanté. Aya et la sorcière est un peu à l’image de ce monde désenchanté qui tente de continuer à briller à l’aide d’artifices commerciaux qui ne séduisent en réalité personnes.
Plus que jamais, dans la vie réelle comme dans le monde du cinéma, nous attendons un grand rebond d’inspiration, une nouvelle renaissance caractérisée par la douceur, la simplicité et surtout l’honnêteté qui faisaient l’esprit des films du Studio Ghibli.

Aya et la sorcière est disponible depuis le 18 novembre en France sur Netflix.
Stéphane Hubert
Pour un média libre et indépendant sur le Japon, soutenez Poulpy 🐙 sur Tipeee !